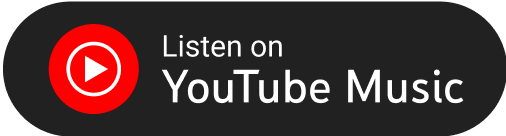Discover key insights from Scotiabank’s 7th Sustainability Summit, where global finance met bold ideas on the future of sustainability.
40 min listen
Episode summary:
In this special episode of Market Points, Patrick Bryden, Managing Director and Global Head of Thematic and Sustainability Investment Research at Scotiabank, presents highlights from the 7th Annual Scotiabank Sustainability Summit. Set against a backdrop of shifting geopolitics and renewed debate over the role of sustainability in global finance, the summit brought together investors, academics, and corporate leaders from around the world. With reflections from members of Scotiabank’s Sustainable Finance and Global Equity Research teams, this episode captures key moments from two days of timely and thought-provoking conversation around the future of sustainability.
Podcast Speakers

Patrycja Drainville
Director, Sustainable Finance

Cambyse Parsi
Director, Sustainable Finance

Daniel Gracian
Director, Sustainable Finance

Benjamin de Wit
Senior Research Associate, Global Equity Research

Melissa Menzies
Director, Sustainable Finance

Zeeshan Nayani
Associate, Global Equity Research
Moderator

Patrick Bryden
Managing Director, Global Head of Thematic and Sustainability Investment Research
Announcer: You’re listening to the Scotiabank Market Points podcast. Market Points is designed to provide you with timely insights from Scotiabank Global Banking and Markets leaders and experts.
Patrick Bryden: Welcome to Market Points. I’m Patrick Bryden, Managing Director and Global Head of Thematic and Sustainability Investment Research at Scotiabank. On June 10th and 11th, 2025, we hosted international asset managers, investors, academics, and corporate leaders at the 7th Annual Scotiabank Sustainability Summit in Toronto.
I can’t believe it’s already been seven years. I’ve been a part of the Sustainability Summit since the beginning, and I can tell you this year was a year like none other. The current geopolitical environment set the stage for lively debate and provided the catalyst for many of us in Sustainable Finance and Global Equity Research to refocus on the fundamentals and the real impact of sustainability on economic growth, risk management, and the investment process.
On this episode of Market Points, my colleagues and I reflect on some of our favourite moments from the 2025 Sustainability Summit.
We’ll hear from Scotiabankers, Melissa Menzies, Cambyse Parsi, Daniel Gracian, Benjamin de Wit, Zeeshan Nayani, and Patrycja Drainville later in the episode. But first, I’d like to talk to you about my personal favourite that really got to the heart of the matter.
If this year’s summit had a theme, it certainly was the future of sustainability, which was the topic of our opening panel featuring Martin Grosskopf, VP and Portfolio Manager from AGF Investments; Michael Jantzi from the International Sustainability Standards Board and former CEO of Sustainalytics; Deborah Ng, Head of ESG & Sustainability at Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co.; and Stern School of Business at NYU Finance Professor and ESG skeptic, Aswath Damodaran.
Now, I grew up in a house with four boys and most of the time it was like Lord of the Flies, and the dinner table was a place for lively debate. So perhaps that is the reason I loved moderating this particular panel. And like my brothers, Professor Damodaran certainly did not pull any punches.
Aswath Damodaran: When you talk about sustainability, what version of sustainability are we talking about? Are we talking about sustaining the planet? Planet sustainability, which I think we all share is a common objective. Are we talking about product sustainability? A very different concept? Are we talking about business sustainability?
You think they all go together. But, not necessarily. I can give you examples of a company that makes a more sustainable product but essentially goes out of business as a company.
Let’s say Gillette, right? Let’s assume you can make a sustainable razor blade, a blade that you never have to throw away. Great for the planet, right, but terrible for the company. So, by leaving things fuzzy, it might serve your purposes, but it makes people cynical about what you’re trying to measure. You want to be a more sustainable company, except the fact that you have to be less profitable.
And don’t give me anecdotal evidence. I can give you counter anecdotal evidence. Collectively, being more sustainable or paying heed to ESG will make you a less profitable company. And I think we have to start with that. And if you’re an investor, this is going to create huge issues for you. We talked about the fiduciary responsibility you have as investors.
If you have a fiduciary responsibility as an investor and you decide on your own to go into adding sustainability and ESG constraints, you are going to actually lower your returns. I mean, it’s a very simple optimization problem. An unconstrained optimal will always deliver a better result than a constrained optimal.
In what universe can you add sustainability and ESG constraints and tell me that your constrained optimal is better than your unconstrained optimal? So, we have to accept the fact that if you decide to take the sustainability and ESG route, you are going to get a lower return on average over time.
Patrick Bryden: So, that was what the “Dean of Valuation” had to say about what he sees as some of the challenges with ESG and sustainable investing. The counterpoints were equally as vigorous on the other side of the debate, and other panelists definitely tried to take him to task. Here’s Michael Jantzi.
Michael Jantzi: But there was a quote, which is unattributed, and you’ve probably heard it, but it’s a quote that I have referred to many, many times over the course of my career, and it’s sustained me at some challenging times, especially in my former life when I was a CEO of Sustainalytics building a business. And the quote is, is this: “First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win”.
And so, I think probably all of us on this stage have been ignored. We’ve been laughed at, and the fight is now on in this space. That quote helps me place where we are right now because I’ve long believed this is just a process. This is a reflection of what is now a maturing industry.
The fact is that we’re growing up and it is complex and there’s a lot of ambiguity in all those things around it, but that’s what I would expect at this point in the cycle. And it’s a lot more fun to be navigating these challenges than it is to be ignored. So that’s the perspective I bring to this.
The fact is the fundamental, the core, premise of sustainable finance has remained intact from my perspective, which is that material sustainability-related risks and opportunities can affect an entity’s prospects over the short, medium, and long term.
Patrick Bryden: I know as the summit organizer and enthusiastic participant, this meaningful dialogue and debate on the future of sustainability was a great way to kick off the panel discussions and lead to a lot of engaging conversations at the cocktail party later that evening. We believe these different viewpoints are representative of the broader marketplace whereby there are different constituents with different investment strategies.
In our view, some of the pushback to sustainable investing in recent years has been valid. Everything tends to cycle in markets, and while there have been headwinds of late, we expect a significant portion of the marketplace to continue to adhere to sustainability principles in the investment process, particularly given it’s underpinned by secular trends that we do not expect to go away anytime soon.
Melissa Menzies: I’m Melissa Menzies, Director of Sustainable Finance at Scotiabank. Artificial intelligence requires an immense amount of energy. With AI becoming more and more pervasive, how will we meet its power demand?
One of my favourite panels at the summit this year was AI data centers power and emissions, featuring an incredible lineup of speakers. Jane Bird, Senior Vice President of Sustainability Management at Brookfield Renewable Partners; Christina Fung, Senior Vice President, Consulting Services at CGI; Kris Aksomitis, Director of Commercial Power Development & Strategy at Power Advisory; and Alex de Vries, the founder of Digiconomist, a platform that conducts research into the unintended consequences of emerging technologies.
Alex de Vries shed a lot of light on the actual energy consumption coming from AI and the likely impacts on global emissions.
Alex de Vries-Gao: So, what I found is that the power demand of AI by the end of last year was probably already equivalent to about well 20% of total data center electricity consumption around the globe. So, this is the data centers for all purposes. AI represents 20% of that total power consumption number.
And then in this case, we’re talking about 20% of 415 terawatt hours of electricity consumption, which is in itself maybe not a meaningful number, but this ultimately comes down to as much power consumption as a country like the Netherlands, my home country, in total. That was by the end of last year.
And I also found that through this year, this number can double again. So, by the end of this year, we could be talking close to half of all data center electricity consumption ultimately being used for just AI. And that means we’re essentially going to be adding another the Netherlands in terms of power demand for AI on the global grid somewhere this year alone.
So, I think there’s a big challenge here in translating power demand to environmental consequences. I will note that in general, because this growth is so fast and so massive that is going to probably drive up the reliance on fossil fuel. Simply because in general, we are already in energy transition. We are prioritizing renewables as much as possible. And renewables are also generally only a limited part of our total power capacity.
Melissa Menzies: So, we have energy consumption ramping up at incredible scale, coupled with the development of renewable energy sources that will not keep pace, and how could they? Global data center demand is expected to grow two and a half times by 2030 from present day with hyperscalers and AI data centers becoming the most common models for the future.
It seems to me that there is an opportunity to develop energy- and resource-efficient solutions at the supply level that will greatly reduce the energy needs of the data centers powering AI technology. And of course, this underscores the need to ramp up capital deployment into sustainable energy infrastructure around the world.
In the meantime, Alex left us with this to consider on the demand side.
Alex de Vries-Gao: Some of these models use a lot more power than others, so then you can start making some responsible decisions. But again, you need data for that first. Whenever you are thinking about potentially using AI you can also take a little bit of a step back and think about the problem you’re trying to solve before you just force fit a solution like AI on it.
Because you know, this happens a lot with emerging technologies where there’s a lot of buzz surrounding this technology and people start using it for everything. It’s kind of like, hey, you have a hammer, you start looking for nails. But it is just not always the best solution. So probably 9 out of 10 times it’s not AI. So that’s, that’s a little something you can do. But I think the real mitigation will not come until we get better data to make really effective decisions on.
Melissa Menzies: A profound statement. Certainly, something to consider that we may be overlooking. I know I’ll probably think twice next time before opening ChatGPT. Although experimentation is key to understanding AI and unlocking its power in new areas, it’s highly likely that this massive projected demand growth ultimately becomes a major factor in supply-side power solutions as we continue to decipher and understand its real world, GHG emissions impacts and other key environmental and social considerations.
Cambyse Parsi: I’m Cambyse Parsi, Director of Sustainable Finance at Scotiabank. Sustainability is about more than climate change and renewable energy. It’s a framework that looks to build lasting global prosperity across generations by aligning our economic systems with the health of people, places, and the planet.
So, at this year’s Sustainability Summit, one of my favourite panels was the one entitled Advancing Indigenous Economic Reconciliation. The panel featured three incredible guests: Tabatha Bull, President & CEO of the Canadian Council for Indigenous Business; Michael Bonshor, Board Chair of the Canadian Indigenous Loan Guarantee Corporation; and Clint Davis, CEO of Cedar Leaf Capital, Canada’s first majority Indigenous owned investment dealer.
Mike Bonshor really helped frame the discussion by considering how we use the term reconciliation. He proposed a more constructive approach to address economic growth and development across Indigenous communities.
Michael Bonshor: I think part of the challenge is that it’s become kind of a homogenous term, intended to mean something collectively.
And I don’t think we can look at it that way. I think First Nations have a perspective on – Indigenous community has a perspective on – what they’re working towards. And from a First Nations rights and title perspective, or from a treaty rights perspective, they’re looking for a time and place where their title and rights meets economic opportunity.
That’s what they’re working towards. And by and large, there’s still a gap there. I think government uses the term reconciliation as well, different levels of government, and I think they look at it from the standpoint of, you know, where their jurisdiction and where their responsibility meets opportunity too.
But it’s different. I would say that’s a different perspective. And, oh, the guy from NYU kind of stirred the pot, so I don’t mind saying some things. From an industry standpoint, you know, that’s where I’ve been probably the most discouraged, to be honest.
And from the standpoint of it can become a marketing campaign. It can become this year’s brochure. And I think that’s at the far end of the spectrum in terms of where we don’t want to see it go in terms of driving tangible change. And so, in where the spaces that I work in, including the Loan Guarantee Corporation, I prefer to use the term “reconstruction”.
Economic reconstruction. Because I think that’s the kind of language that we need to consider and use when we’re talking about shaping or reshaping the Canadian economy.
Cambyse Parsi: Mike and the Canadian Indigenous Loan Guarantee Corporation are certainly moving things forward on reconstruction. The corporation announced its first guarantee in May of this year, providing a loan guarantee to support an equity investment by a group of thirty-eight First Nations in British Columbia to acquire 12.5% ownership interest in Enbridge’s West Coast system.
The loan guarantee was used to support a $400 million bond offering that achieved AAA rating from DBRS, effectively tied to the federal rating.
This combination helped achieve competitive and low-cost funds for the Indigenous groups and helped support their investment into the assets that will return to them sustained economic benefits.
We also learned about increased collaboration coming from the private sector. Tabatha Bull provided a great example of the impact that mutually beneficial economic relationships can have when corporates, communities, and government work together.
Tabatha Bull: Maybe I’ll just jump on the Clearwater deal story because, so originally when the Clearwater deal went through, First Nation Finance Authority was able to provide a loan of $240 some million that supported the seven communities in the territory to purchase the fishing rights and licences that were Clearwater’s, which also to talk about self-determination and self-governing for those communities to be able to own those rights in that territory is an exceptional story of reconciliation.
And Premium Brands who partnered with them so that they could buy 50% of the equity loaned them $240 million or something at 10%. And then when First Nation Finance Authority was able to raise additional funds, Premium Brands allowed the communities to refinance a hundred million dollars of that loan at 4.2%.
That’s seven communities who then are able to just change their cash flow into their community. And Chief Terrance Paul I think was quoted to say that meant $3 million a year into his community. That is the story about the ecosystem that’s required from industry, from corporate Canada, and from these organizations like FNFA.
Cambyse Parsi: These transactions are more than a financing story. They’re examples of respect, reciprocity, and long-term thinking. It’s not just about investing alongside First Nations, it’s about stepping back, it’s about listening, and collaborating on community ownership on fair terms.
That kind of partnership doesn’t happen by accident. As Clint Davis from Cedar Leaf Capital reminds us, meaningful collaboration with Indigenous communities starts well before the paperwork by showing up, by doing your homework, and by recognizing the value Indigenous partners bring from day one.
Clint Davis: From a business perspective, looking at forging partnerships with Indigenous communities, first thing, first and foremost, and all of you who work in business yourself, if you want to approach, you know, a new partner, a new client, new customer, you do the research on them, right? So, start with that. Start with the research on the community. Get a good sense of what their governance structure looks like. Is there a modern land claim? Is it historical treaties? Do they have a development corporation? Are there any issues that are in the press that they’re advocating for? What are their priorities in their recent election?
Just get a really good sense, and get the name right too is another thing because I’m Inuit and I don’t know how many times I’ve been referred to as Innu. And Innu are incredible First Nations people in Eastern Quebec and Northern Labrador. And so, just get the names right. And if you, if you have a hard time trying to get it, just talk to somebody and you know, we’ll be able to share that with you.
The other thing is, speak with the right people. You normally start with if they have a development corporation or an economic development officer, start with that person.
Everybody thinks they have to go to the political leader. Chances are you’re not going to get on their agenda anytime soon because they’re dealing with a wide array of issues. Start with talking to the right person. And the right person is somebody who is mandated to kind of develop responsible business within their community.
The third is, and this was actually quoted by Michael Sabia today in the Globe and Mail, which I thought was absolutely very insightful, which is: be there in person. Go and spend some time. That’s when the trust really gets established. And Michael Sabia talked about that today. He’s the CEO of Hydro Quebec. Which is one of the largest utilities in North America. And he talked about, and Tabatha probably knows about this intimately well, but about the amount of travel he’s been doing in communities, speaking to leaders, spending that time. And he said there’s nothing like in-person meetings to really develop that level of trust. Speak less and listen more.
And then finally, which I think many of us or many businesses maybe kind of miss at times, but start with collaboration versus the sales job, right?
So just don’t go in and just say, we got the project. We’re going to walk down the road of trying to get regulatory approval. So now I’m going to sell you to try and get on board versus let’s collaborate, we see you as a real viable partner. You’re not simply a passenger, but you’re bringing value to the relationship as well.
Daniel Gracian: I’m Daniel Gracian, Director of Sustainable Finance for Latin America and the Caribbean at Scotiabank. Given Scotiabank’s strong presence in Mexico, I was especially excited for an interview with Yunuen Hernandez at this year’s Sustainability Summit.
Yunuen is Director for ESG Control and Monitoring at the Undersecretary of Finance and Public Credit for the Government of Mexico, and she has been playing a critical role in the development of Mexico’s sustainable finance framework and issuance program.
By looking holistically at sustainability and building in sustainability into federal budgets, Mexico has built a reputation as a global leader in sustainable finance, particularly among developing economies.
Given the other panel’s concentration on climates, it was very interesting to learn more about how Mexico balances both the social and green elements of sustainability through their programs.
Yunuen Hernandez: Well, the rationale of why our bonds are linked to SDGs is because our federal budget is linked at the federal programs, how they contribute to the SDGs targets.
So that was like the rationale behind why our framework is built upon the 2030 Agenda, and because also Mexico has this governance and the National Committee of the 2030 Agenda, technical committees where we follow up and monitor the policy around sustainability with other ministries. We also incorporate in our framework that we have receiving pretty positive feedback on our geospatial criterion.
It’s been recognized to be very innovative. In the sense that this geospatial criterion, it’s a tool that identifies how the social programs are being allocated to the most vulnerable regions in our country.
We cannot focus only on the climate agenda. Mexico has social challenges to reduce gaps. So, it makes sense that why actually our first SDG bond was linked only to social SDGs, like for instance, education, health. And it was during the pandemic year, and after two years, we started incorporating green SDGs, you know, biodiversity, climate change, energy, et cetera.
So, this is like our narrative that we need to push towards sustainability, which is green and social at the same time.
Daniel Gracian: That first SDG bond Yunuen referred to, that wasn’t only Mexico’s first. It was the first of its kind in the world. As a global leader in sustainable finance, Mexico has become a reference to guide the way through the current challenges facing the market.
And in our conversation with Yunuen, she thoughtfully advised us to keep a long-term perspective to navigate political cycles.
Yunuen Hernandez: Despite this anti-ESG news and so on, what we perceive is that it’s natural, the country adapting to the current political point of view.
But there is still demand on those instruments and even though we’ve seen this on the supply side, significant decrease, at least in this year, we know that there is appetite for these instruments, so that’s why we’ve been able to tap international and local markets with these instruments.
I think that the sustainable finance should not be seen as a short-term strategy but rather has to be long term in order that political cycles do not affect your sustainable finance strategy. So, a way to do so is doing a long-term strategy such as like the sustainable financing mobilization strategy, targeted to 2030, for instance.
Daniel Gracian: At the end of the conversation, we asked Yunuen for her thoughts on what we all need to be thinking about as we continue to build out our own sustainable finance programs and strategies across public and private sectors, and she gave us these five key takeaways.
Yunuen Hernandez: I think it’s important, first of all, that your strategy has to be accountable. Showing accountability through the reports.
The second point, I will say, transparency along the whole process is key. To show, not when you’re structuring at the bond and tapping the market, but also in the post-issuance phase.
Third, I would think it’s key to enable and promote information, access to everyone on the ESG side so everyone is well informed when taking decisions. So, we need to share this knowledge to everyone.
Four, I would say, the standardization is key to talk everyone in the same language and not because you want to compare to others and become competitive, I would say it’s just to become a reference. And also, for you to see if you, whether you, are not doing the right things or seeking for opportunity areas of improvement in your strategy.
And finally, building capacity. Again, in order to push toward this agenda, we have no time to slow down the pace on the efforts made, but we need to care a lot on building capacity across the different sectors, so we talk all in the same language and push in the same direction.
Ben de Wit: I’m Ben de Wit, Equity Research Associate at Scotiabank.
Our first keynote conversation of the Summit this year was an interview with Jackie Forrest, the Executive Director of ARC Energy Research Institute and the co-host of the ARC Energy Ideas podcast.
We covered a lot of topics over two days at our summit, but Jackie raised some important points within her keynote that were potentially a bit unexpected for some people to hear, specifically that the outlook for fossil fuel demand looks stable or even growing.
And that while some investors might have dismissed opportunities to invest in conventional energy because of concerns about their emissions in longer-term suitability, we are seeing the tone from governments and across markets change to one that’s more greatly prioritizing energy security and reliability, particularly as aggregate global energy demand continues to grow.
Jackie Forrest: History has shown us that it takes a long time to change our energy systems because we have so much momentum in the system. So many investments have been made that rely on the types of energy that are used today that it’s not easy to change them overnight.
So, you know what? Coal is a great example. Everyone thinks coal is dead. Well, actually, we use more primary energy from coal than we do from natural gas today by quite a bit. And coal hasn’t peaked. And I actually don’t think coal’s going to peak in the next few years because we’re still seeing quite a bit of investment in new coal in places like India and China.
So, coal is not dead. And we just added clean energy on top of the fossil fuel system, which is growing rapidly, but still relatively small because 80% of our primary energy actually comes from oil, gas, and coal today, and only 20% from clean energies.
Ben de Wit: Jackie’s comments seem to highlight the changes in approach we’ve seen recently in Canada and in many other countries as well. As we all appear to be navigating a balance between goals of achieving net zero over the longer term, growing our economies, and also understanding what alignment with global trade partners might look like going forward.
Historically, Canada’s economy has been heavily resource dependent, and while the recently passed, Bill C-5 appears to be focused on ramping up the ways we leverage our traditional strengths and prioritize getting things done. I think it is fundamental to think about how Canada finds a balance in the longer term that considers what the incentives are for investing in Canada and diversifying the opportunities available within our economy.
Jackie further highlighted a few particulars later in her keynote conversation that touched on this.
Jackie Forrest: Well, you know, first of all, for these big major projects, Canada has a trust issue to get over in terms of attracting big private capital back to this country. A lot of, as I said earlier, a lot of people have come, spent money, and found that Canada isn’t really open for investment, and we have to change that.
And so, this bill is really important. This signal to the market that the federal government supports the development of major infrastructure projects is going to be critical to bringing capital back, but I don’t think in itself it’s enough. I do think we have a real policy pancaking mess. You talked about it earlier. We have to fix some of the underlying policies.
I’ll give you an example. Let’s say I’m right, and I hope I am, that LNG export facilities are part of these nation building projects. So, what you’re going to do is put a green light on the exporting of gas off our West Coast, which is good. It diversifies us away from the Americans. It creates more optionality. We can actually grow our production because now we have new export points.
Right now, we are so constrained that our gas is trading at like a dollar Canadian per gigajoule, like a third of the price or a quarter of the price that the Americans get. So, we start to get a fair price for our resources. But at the same time, we have this oil and gas emissions cap, which is like a red-light policy on the supply side. So why would you build an export terminal if you think that the supply side is constrained and will not grow? It’s like you’re going to build a big beautiful empty pipeline. So, we need to get rid of some of the policy pancaking and contradictions that we have right now.
Ben de Wit: I think a longer-term consideration is how Canada is also attracting investment in major infrastructure and nation-building projects that can help grow other sectors as well. And also finding some consensus on ways to make our economy more robust for generations ahead.
Zeeshan Nayani: I’m Zeeshan Nayani, Thematic and Sustainability Investment Research Associate at Scotiabank.
Sectors such as energy, transportation, food production, and building infrastructure have been notoriously difficult to decarbonize. One of the sessions that I was the most excited about was the panel session Decarbonizing and Moving Critical Modern Building Blocks, which highlighted how corporations are moving the needle to address decarbonization challenges in these hard to abate sectors.
The panel featured great leaders from sectors at the center of it all. Francois Belanger, Head of Sustainability at Canadian National Railway Company; Dr. Stuart Lunn, VP Policy & Advocacy at Imperial Oil Limited; Tim Faveri, VP Global Sustainability at Nutrien; and Resha Watkins, VP of Sustainability, North America, at Votorantim Cimentos, Brazil’s largest cement company and the eighth largest in the world.
These amazing panelists showcased their knowledge and innovations in that space. What resonated with me the most was when they highlighted how their companies are interconnected in the overall value and supply chain, such that one innovation has the ability to move multiple industries towards a decarbonized future.
Tim Faveri: And all the work that Imperial does to decarbonize your products filter through to a company like Nutrien. If we burn your lower-carbon natural gas, the carbon intensity of our nitrogen is lower, and then we can pass that on to downstream actors that, the food companies, CPG companies that are asking for lower-carbon products to try and influence their Scope 3.
And we can do that scientifically and measure that through our lifecycle assessments. What we feel is the really, really big opportunity is then incentivizing farmers to adopt these kinds of practices or use these products. And most important thing around, around working with farmers is making sure that they are incentivized to change this practice.
There’s only two ways farmers make money, improve their yield and get a better price for more of their crop or reduce their input cost. So, an incentive for them to change practice is really important. And actually, it’s in, in the biodiesel market that we’re seeing in the United States, particularly in the corn belt, where biodiesel manufacturers are providing the largest incentives to, say, corn growers, canola growers for those products, for that lower-carbon-intensity fuel. And that’s really exciting to farmers.
They’re all very interested in that. Because we work on field with farmers through our agronomists and our crop input providers, we can measure the application of practices and lower carbon fertilizers that produces a lower carbon intense canola, or corn, which goes into your facility, and then we all hopefully get a higher price for that, right? And we are also providing a great benefit from lower greenhouse gases.
Francois Belanger: And just building from that, so Tim, you were saying before that food is in the middle of everything. Well, I like to think rail is in the middle of everything.
So, when we think about biofuels, I mean we do ship some of the potash that will go to the farmers. And then we do ship some of those feed stocks that goes to the refineries, and then we ship the product out of the refineries. So, we see the whole picture about what’s happening with renewable fuels, and we see that as a growth opportunity for us from a from business perspective, which is quite fun and very exciting about the opening there, Strathcona.
On the consumer side, as I was saying before, like this is our key lever for 2030 in the next few years, and we see that as an opportunity to reduce our emissions right now without any significant change to our locomotive to up to a certain blend. And so, we’re already increasing our blends.
And in 2024 we were approximately at 10% content for our locomotive fuel from renewable fuel, so a mix of biodiesel and renewable diesel. So that helps reduce our emission right away. And then by doing that we help reduce our customers’ Scope 3 transportation emissions directly.
Patrycja Drainville: Hi, I’m Patrycja Drainville, Director of Sustainable Finance at Scotiabank.
In light of the political and media cycle surrounding ESG investing, it is more important than ever to hear from the investor community. Ultimately, market-driven solutions only work if there’s sustainable demand. And after all, investors were the ones who put ESG on the map by making it a more prominent feature in investment strategies.
That’s why I was most excited to hear from the participants on the panel Investor Perspectives on the Evolution of Sustainable Investing. Scotiabankers Cambyse Parsi and Francisco Suarez moderated a dynamic discussion featuring Patrick O’Connell, Director of Responsible Investing Portfolio Solutions and Research at AllianceBernstein; Heather Sharp Lead ESG Research and Senior Analyst at Jarislowsky, Fraser Limited; Marina Severinovsky, Head of Sustainability North America for Schroeders; Daniel Yungblut, Vice President and Head of Research at Scotia Global Asset Management; and Barbara Zvan, President and CEO of the University Pension Plan Ontario.
The investors on the panel agreed that a pragmatic approach is needed for ESG, but that managing sustainability risks and opportunities is essential for achieving long-term risk-adjusted returns.
Both Barbara and Patrick spoke about the importance of clarity, financial materiality, and evidence-based decision making, rather than simplistic exclusions or quotas when considering sustainability in investments.
Barbara Zvan: So, our approach, it’s rooted in financial materiality and that is because, you know, by law pension plans have to be managed in the best interest of their members.
And that’s typically, and sometimes even explicitly, financial best interest of members. And thus, we always have looked at this from the lens of financial materiality. So, it’s much more of the process; it is not the product. And really what we’re looking at it is from the fact that we have a very long-term horizon, right?
I typically have people that come in early twenties to late twenties for staff, faculty are a little bit older, and I have them for a really long time, right? I’m still paying their pension checks when they’re 90. So, these are risks that manifest over that time horizon.
Patrick O’Connell: I think clarity is something that we’ve had to be a lot better at over the last couple of years. If in the past you got away with kind of confusing words – sustainable, ESG, integrations, impact – I think what we have to do now is be very prescriptive and very clear of what we’re doing.
We are a large asset manager, manage about $800 billion of assets. Kinda the same kind of categories, the bulk of it being in integration, with a lot of clients also on the sustainable or impact side. But I think integration is what we really need to be talking about today.
And just being very clear of what do we mean by integration? What do we not mean by integration? And it’s all about financial materiality. How do we boost long-term results? And I’d bucket in kind of section two is the why, the materiality of back testing, showing that these are themes that are not about altruistic concepts.
This is something that we think helps you survive alpha from a bondholder or a stockholder point of view. And just being really firm on that. And that’s, I think, a message that resonates.
Patrycja Drainville: Ultimately the biggest conclusion is that ESG has to deliver improved financial outcomes for investors. Institutional asset manager Jarislowsky, Fraser had been integrating ESG into their bottom-up process before it was even called ESG. When questioned about third-party empirical evidence that was supporting their approach around ESG investing, Heather Sharp raised the recent meta study out of NYU.
Heather Sharpe: I’ll just talk about a big NYU meta study, just looking at thousands of studies, including other meta studies. Performance period of 2015 to 2020. Obviously, one or two things has happened in the world since 2020, but nonetheless, what the meta study concluded was that ESG had a notable positive correlation with corporate financial performance.
So, things like return on equity, return on assets, actual stock price, that this increased over the long term, and that they also had less volatility in down markets. But if we’re looking at, again, that kind of fundamental bottom-up perspective of looking for, we think that integration of those financially material ESG factors will lead to better companies over the long term. And then from those better companies, you can build a better portfolio for better long-term risk-adjusted returns.
Patrycja Drainville: This really underscores that alpha is being generated not from exclusions, but from integration of ESG principles from the bottom up.
I think this is a big takeaway for all investors. Marina Severinovsky at Schroders, a firm that conducts a tremendous volume of proprietary research around sustainability, reminded us that both financial performance and impact can come from companies in transition.
Marina Severinovsky: So, when we look at climate, for example, we have kind of three categories: climate improvers, and then also kind of the low carbon companies, already low carbon, and then climate solutions.
And actually, what we find is it’s the improvers category – it’s that kind of transition or action category – which is the biggest and most diverse category across sort of industries and sectors that has had the financial outperformance. But it also has contributed the greatest kind of real-world emissions reduction versus the other categories because the solutions companies and the low carbon companies are already pretty low carbon, right?
So, if you want bank for buck, like better improvement, that’s where you go, is that sort of action transition piece.
On engagement, adding value, we have published analysis on, you know, the companies we engage with are more likely to see their emissions intensity reduce, and they’ve had higher returns.
It’s not causation, but it’s certainly very high correlation. We’ve also seen very high correlation of engagement and proxy voting around governance, correlated with sort of sustained, improved company performance.
So again, as a tool of what we can do as investors, I think that active ownership piece is really critical.
Patrick Bryden: Incredible insights across the board. It was a real challenge to put this together. There were so many great moments over the two days we spent together in Toronto.
I’d really like to thank my colleagues Melissa Menzies, Cambyse Parsi, Daniel Gracian, Benjamin de Wit, Zeeshan Nayani, and Patrycja Drainville for their contributions to this episode, and of course to all our panelists and participants at the seventh Annual Scotiabank Sustainability Summit.
We would absolutely love to see you at the summit in 2026. If you would like to help shape the future of sustainability and be a part of the conversation, please be sure to reach out to us for more details.
Thanks for listening.
Announcer: Thanks for listening to Scotiabank Market Points. Be sure to follow the show on your favorite podcast platform, and you can find more thought leading content on our website at gbm.scotiabank.com.
La transcription suivante a été générée à l'aide de la traduction automatique.
Présentatrice : Vous écoutez le balado Le point sur les marchés de la Banque Scotia. La série de balados elle vise à vous présenter les perspectives des leaders et experts des Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia.
Patrick Bryden : Bienvenue au balado Le point sur les marchés. Ici Patrick Bryden, directeur général et chef mondial, Recherche – Investissements durables et ciblés à la Banque Scotia. Les 10 et 11 juin 2025, nous avons accueilli à Toronto des gestionnaires d’actifs internationaux, des investisseurs, des universitaires et des chefs d’entreprise à l’occasion du 7e Sommet annuel de la Banque Scotia sur la durabilité.
Je n’arrive pas à croire que ça fait déjà sept ans. Je participe à ce Sommet depuis sa première édition et je peux vous dire que cette année n’a pas été une année comme les autres. Le contexte géopolitique actuel a donné lieu à de nombreux débats animés, et a rappelé à nos équipes de la Finance durable et de la Recherche sur les actions mondiales qu’il est essentiel de nous recentrer sur les principes fondamentaux et sur l’incidence réelle de la durabilité sur la croissance économique, la gestion des risques et l’investissement.
Dans cet épisode, mes collègues et moi allons discuter de quelques-uns de nos moments préférés du Sommet sur la durabilité de 2025.
Un peu plus tard, nous laisserons la parole à Melissa Menzies, Cambyse Parsi, Daniel Gracian, Benjamin de Wit, Zeeshan Nayani et Patrycja Drainville, qui sont des employées et employés de la Banque Scotia. Mais d’abord, j’aimerais vous parler de mon moment favori, qui est au cœur du sujet.
Si je devais attribuer un thème au Sommet de cette année, ce serait l’avenir de la durabilité. C’était d’ailleurs le sujet de la première table ronde, qui réunissait Martin Grosskopf, vice-président et gestionnaire de portefeuille à Placements AGF; Michael Jantzi, membre du Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité et ancien PDG de Sustainalytics; Deborah Ng, responsable de l’ESG et de la durabilité à Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. et Aswath Damodaran, professeur en finance à la NYU Stern School of Business, sceptique lorsqu’il est question des critères ESG.
J’ai grandi dans une maison où nous étions quatre garçons. Et, à l’image de Sa Majesté des mouches, l’heure du souper était souvent remplie de débats animés. C’est peut-être pour ça que j’ai adoré animer cette table ronde : comme mes frères, le professeur Damodaran n’a certainement pas mâché ses mots.
Aswath Damodaran : Lorsque vous parlez de durabilité, quelle version de celle-ci avez-vous en tête? S’agit-il de préserver la planète? Je pense que la durabilité de la planète est un objectif que nous avons tous en commun. S’agit-il de la durabilité des produits, qui est un concept très différent? S’agit-il de la durabilité des entreprises?
On peut penser que tout ça va ensemble, mais pas nécessairement. Je peux vous donner des exemples d’entreprises qui fabriquent des produits plus durables, mais foncent droit vers la faillite.
Prenons Gillette, par exemple. Imaginez qu’il soit possible de fabriquer une lame de rasoir durable, une lame que vous n’auriez pas besoin de jeter. C’est bon pour la planète, n’est-ce pas? Mais c’est aussi mauvais pour l’entreprise. Donc, en laissant les choses floues, cela peut servir vos objectifs, mais les gens commencent à se méfier de vos intentions. Vous voulez être une entreprise plus durable, sauf que cela voudrait dire être moins rentable.
Et ne me donnez pas de contre-arguments anecdotiques, je peux moi-même vous en citer. Mais, généralement, le fait d’être plus durable ou de tenir compte des ESG fera diminuer la rentabilité de votre entreprise. Je pense que nous devons commencer par là. Et si vous souhaitez investir, cela vous posera d’énormes problèmes. Nous avons parlé de l’obligation fiduciaire qui vous incombe en tant qu’investisseurs.
Si vous avez une obligation fiduciaire et que vous décidez de votre propre chef d’ajouter des contraintes en matière de durabilité et d’ESG, vous allez en réalité réduire vos rendements. En fait, c’est un problème d’optimisation très simple : une optimisation sans contraintes donnera toujours un meilleur résultat qu’une optimisation sous contraintes.
Dans quel monde serait-il possible d’ajouter des contraintes en matière de durabilité et d’ESG et d’obtenir de meilleurs résultats? Nous devons donc accepter le fait que, lorsqu’on décide de suivre la voie de la durabilité et des ESG, on obtiendra en moyenne un rendement inférieur au fil du temps.
Patrick Bryden : Vous venez donc d’entendre l’avis du «doyen de la valorisation» à propos des défis qui, selon lui, découlent des ESG et de l’investissement durable. Les contre-arguments étaient tout aussi vigoureux du côté opposé, et d’autres panélistes ont essayé de le prendre à partie. Écoutons donc Michael Jantzi.
Michael Jantzi : Une citation d’un auteur anonyme, que vous avez probablement déjà entendue, m’est revenue à l’esprit à plusieurs reprises au cours de ma carrière. Elle m’a aidé à traverser des périodes difficiles, surtout à l’époque où j’étais PDG de Sustainalytics et que je construisais une entreprise. C’est celle-ci : «D’abord ils vous ignorent, ensuite ils se moquent de vous, après ils vous combattent et, enfin, vous gagnez.»
Je pense que tout le monde sur cette scène a déjà été ignoré. On s’est moqué de nous, et le combat est désormais engagé dans notre domaine. Cette citation m’aide à comprendre où en est la situation, car je pense depuis longtemps que tout ça n’est qu’un processus et que cela reflète un secteur en pleine maturation.
C’est simple : le temps passe, la situation est complexe et regorge d’ambiguïtés, mais c’est ce à quoi on peut s’attendre à ce stade du cycle. Et il est beaucoup plus intéressant de relever ces défis que d’être ignoré. Voilà mon point de vue sur la question.
Selon moi, le principe fondamental de la finance durable est resté le même : les occasions et les risques matériels liés à la durabilité peuvent avoir une incidence sur les perspectives d’une entité à court, moyen et long terme.
Patrick Bryden : En tant qu’organisateur et participant enthousiaste du Sommet, je sais que ce débat constructif sur l’avenir de la durabilité a été une excellente façon de lancer les tables rondes, et a donné lieu à de nombreuses conversations intéressantes lors du cocktail qui s’est tenu plus tard dans la soirée. Ces différents points de vue sont représentatifs du marché au sens large, puisqu’ils reflètent ses différents acteurs et leurs diverses stratégies de placement.
Selon nous, certaines oppositions à l’investissement durable au cours des dernières années étaient justifiées. Les marchés fonctionnent souvent de manière cyclique. Bien qu’il y ait eu des vents contraires ces derniers temps, nous nous attendons à ce qu’une grande partie du marché continue à adhérer aux principes de durabilité sur le plan des placements, d’autant plus que ce mouvement est étayé par des tendances séculaires qui ne devraient pas disparaître de sitôt.
Melissa Menzies : Ici Melissa Menzies, première directrice, Finance durable à la Banque Scotia. L’intelligence artificielle est extrêmement énergivore, et devient de plus en plus omniprésente. Comment allons-nous répondre à ses besoins en énergie?
L’une de mes tables rondes préférées lors du Sommet de cette année était consacrée à l’alimentation et aux émissions des centres de données pour l’IA. Les panélistes étaient remarquables : Jane Bird, première vice-présidente de la gestion durable à Brookfield Renewable Partners; Christina Fung, première vice-présidente des services de conseil à CGI; Kris Aksomitis, directeur du développement des activités commerciales et de la stratégie énergétique à Power Advisory; et Alex de Vries, fondateur de Digiconomist, une plateforme qui mène des recherches sur les conséquences involontaires des technologies émergentes.
Alex de Vries nous a grandement éclairés sur le sujet de la consommation d’énergie réelle de l’IA et sur les répercussions attendues de celle-ci sur les émissions mondiales.
Alex de Vries : J’ai découvert qu’à la fin de l’année dernière, les besoins en énergie de l’IA correspondaient probablement déjà à environ 20 % de la consommation totale d’électricité des centres de données dans le monde. Et je parle ici des centres de données polyvalents, pour lesquels l’IA représente 20 % de la consommation totale d’énergie.
Dans ce cas, cela représente 20 % de 415 térawattheures de consommation d’électricité, ce qui n’a l’air de rien, mais qui correspond en fin de compte, au total, à une consommation d’électricité équivalente à celle d’un pays comme les Pays-Bas, mon pays natal. Ça, c’était à la fin de l’année dernière, mais j’ai aussi constaté que ce chiffre pourrait doubler cette année. Donc, d’ici la fin de l’année, près de la moitié de la consommation d’électricité des centres de données pourrait être utilisée pour l’IA. C’est comme si nous ajoutions à nouveau au réseau mondial l’équivalent des Pays-Bas en termes de demande d’énergie, seulement pour l’IA.
Nous avons donc un grand défi à relever pour comprendre les conséquences environnementales entraînées par ces besoins en électricité. De plus, d’une manière générale, cette croissance est si exponentielle qu’elle va probablement accroître notre dépendance aux combustibles fossiles. En effet, nous sommes déjà en pleine transition énergétique et préférons avoir recours aux énergies renouvelables dans la mesure du possible, mais celles-ci ne représentent généralement qu’une partie limitée de notre capacité totale de production d’électricité.
Melissa Menzies : La consommation d’énergie augmente donc à une vitesse effrénée, mais le développement des sources d’énergie renouvelables ne suit pas. Et pour cause : la demande mondiale en centres de données devrait être multipliée par deux et demi d’ici à 2030, et les centres de données à très grande échelle et ceux qui sont dédiés à l’IA vont devenir la norme.
Je pense que nous avons là une occasion de mettre en œuvre des solutions d’approvisionnement économes en énergie et en ressources, qui réduiront considérablement les besoins en énergie de ces centres de données. Bien entendu, cela met en lumière le fait qu’il faut intensifier le déploiement de capitaux dans les infrastructures d’énergie durable partout dans le monde.
En attendant, Alex s’est également exprimé au sujet de la demande.
Alex de Vries : Certains de ces modèles d’IA sont beaucoup plus énergivores que d’autres, et nous pouvons ainsi prendre des décisions plus responsables. Mais là encore, il faut d’abord recueillir des données. Lorsque vous envisagez d’utiliser l’IA, vous pouvez également prendre un peu de recul et réfléchir au problème que vous essayez de résoudre avant d’avoir recours à cette solution.
On voit ça souvent avec les technologies émergentes : elles font beaucoup parler et les gens commencent à l’utiliser pour tout et n’importe quoi. C’est un peu comme cette idée selon laquelle, si on a un marteau, on commence à chercher des clous partout, mais ce n’est pas toujours la meilleure solution. Donc, 9 fois sur 10, la meilleure solution n’est probablement pas l’IA. C’est un petit réflexe que vous pouvez adopter. Mais, selon moi, nous ne pourrons pas prendre de mesures correctives tant que nous ne disposerons pas de données claires qui nous permettraient de prendre des décisions vraiment efficaces.
Melissa Menzies : Une déclaration marquante. C’est certainement quelque chose que nous négligeons et devons prendre en compte davantage. Je sais qu’à l’avenir, j’y réfléchirai probablement à deux fois avant d’ouvrir ChatGPT. Bien que l’expérimentation soit essentielle pour approfondir la compréhension de l’IA et étendre ses applications, il est probable que l’explosion de la demande devienne un élément déterminant pour l’offre de solutions énergétiques. Ce phénomène survient au moment même où nous poursuivons notre analyse de son incidence sur les émissions de GES et d’autres enjeux environnementaux et sociaux.
Cambyse Parsi : Ici Cambyse Parsi, premier directeur, Finance durable à la Banque Scotia. La durabilité ne se résume pas au changement climatique et aux énergies renouvelables. Elle représente un cadre pour l’établissement d’une prospérité mondiale durable sur plusieurs générations, basée sur l’alignement de nos systèmes économiques sur la santé des personnes et de la planète.
Ainsi, l’une de mes tables rondes préférées lors du Sommet de cette année portait sur le progrès de la réconciliation économique pour les peuples autochtones. La table ronde réunissait trois panélistes exceptionnels : Tabatha Bull, présidente et PDG du Conseil canadien pour l’entreprise autochtone; Michael Bonshor, président du conseil d’administration de la Corporation de garantie de prêts pour les autochtones du Canada; et Clint Davis, PDG de Cedar Leaf Capital, la première maison de courtage détenue majoritairement par des autochtones au Canada.
Mike Bonshor a particulièrement aidé à structurer la discussion en examinant la manière dont nous utilisons le terme «réconciliation». Il a proposé une approche plus constructive de la croissance économique et du développement des communautés autochtones.
Michael Bonshor : Je pense que le problème vient en partie du fait que ce terme est devenu homogène, représentatif de quelque chose de collectif, et je ne pense pas que nous puissions l’envisager de cette manière. Je pense que les Premières Nations, que la communauté autochtone a ses propres objectifs, qui seraient de trouver un point de rencontre entre les droits et titres des Premières Nations, ou des droits issus des traités, et les occasions économiques.
C’est à ça que cette communauté s’emploie, et dans l’ensemble, il y a encore un fossé à combler. Je pense que différents paliers du gouvernement se servent du terme «réconciliation», mais qu’ils l’envisagent du point de vue de leurs propres juridictions et responsabilités, lorsque des occasions se présentent.
Mais ce n’est pas la même chose, c’est une tout autre perspective. Bon, le gars de l’Université de New York a un peu mis de l’huile sur le feu, alors je n’ai pas peur de m’exprimer franchement sur certains points. Pour être honnête, c’est probablement notre propre secteur qui m’a le plus déçu, notamment lorsque ces idées se transforment en une campagne de marketing, et pourraient se retrouver sur les brochures de cette année. Je pense que c’est à l’opposé de ce que nous souhaitons voir lorsqu’il est question de réellement changer les choses. C’est pourquoi, dans tous les espaces où je travaille, y compris la Corporation de garantie de prêts, je préfère utiliser le terme «reconstruction», et parler de reconstruction économique. À mon avis, c’est le type de langage que nous devons employer lorsque nous parlons de bâtir ou de transformer l’économie canadienne.
Cambyse Parsi : Il est certain que Mike et la Corporation de garantie de prêts pour les autochtones du Canada font avancer les choses en matière de reconstruction. La corporation a annoncé la provision de sa première garantie de prêt en mai dernier, utilisée afin de soutenir un placement en actions par un groupe de trente-huit Premières nations en Colombie-Britannique dans l’acquisition de 12,5 % des parts du Réseau de Westcoast d’Enbridge.
La garantie de prêt a été utilisée pour soutenir une émission d’obligations de 400 millions de dollars, pour laquelle DBRS a attribué la note de crédit AAA, puisque celle-ci est liée à la note fédérale.
Ces résultats ont permis aux groupes autochtones d’obtenir des fonds compétitifs et peu coûteux et de soutenir leurs placements dans des actifs qui leur rapporteront des avantages économiques durables.
Nous avons également appris que le secteur privé était de plus en plus ouvert aux collaborations. Tabatha Bull a fourni un excellent exemple des avantages que peuvent avoir des relations économiques mutuellement avantageuses lorsque les entreprises, les communautés et le gouvernement travaillent ensemble.
Tabatha Bull: Je vais revenir sur l’histoire de Clearwater. À l’origine, lorsque le rachat de Clearwater a été effectué, l’Autorité financière des Premières Nations a pu accorder un prêt d’environ 240 millions de dollars qui a permis aux sept communautés du territoire d’acheter les droits et permis de pêche qui appartenaient à Clearwater. Nous avons donc ici un parfait exemple de réconciliation, puisqu’à travers l’acquisition de ces droits, ces communautés retrouvent une part de leur autodétermination et de leur autonomie gouvernementale.
La société Premium Brands s’est associée à ces communautés pour leur permettre d’acquérir une participation de 50 % grâce à un prêt d’environ 240 millions de dollars à un taux de 10 %. Puis, lorsque l’Autorité financière des Premières Nations a pu recueillir davantage de fonds, Premium Brands a permis aux communautés de refinancer une centaine de millions de dollars de ce prêt à un taux de 4,2 %.
Nous avons donc sept groupes qui sont en mesure de réinvestir les flux de trésorerie au sein de leur propre communauté. Il me semble que le chef Terrance Paul a déclaré que cela représentait 3 millions de dollars par an pour sa communauté. C’est cela qu’on doit attendre des sociétés canadiennes et des organismes comme l’Autorité financière des Premières Nations.
Cambyse Parsi : Ces transactions vont au-delà d’une simple question de financement : elles mettent en lumière le respect, la réciprocité et la réflexion sur le long terme. Il ne s’agit pas seulement d’investir aux côtés des Premières Nations, mais aussi de prendre du recul, d’être à l’écoute et de participer à la propriété collective dans des conditions équitables.
Ce type de partenariat ne s’établit pas par hasard. Comme nous le rappelle Clint Davis de Cedar Leaf Capital, une collaboration fructueuse avec les communautés autochtones se bâtit bien avant les formalités administratives : il faut être présent, faire des recherches et reconnaître la valeur des partenaires autochtones dès le départ.
Clint Davis : Du point de vue des entreprises, lorsqu’il s’agit de forger des partenariats avec les communautés autochtones, la première chose à faire, c’est d’effectuer des recherches sur celles-ci. Ceux d’entre nous qui sont dans le domaine des affaires savent que c’est ce qu’il faut faire pour approcher un nouveau partenaire ou un nouveau client, n’est-ce pas? Donc, c’est là qu’il faut commencer, par mener des recherches sur la communauté en question. Faites-vous une idée précise de sa structure de gouvernance. Existe-t-il une revendication territoriale moderne, ou s’agit-il d’un traité historique? La communauté a-t-elle une société de développement? Y a-t-il des articles de presse qui illustrent les idées qu’elle défend? Quelles étaient ses priorités lors de ses dernières élections?
Apprenez à bien les connaître, et appelez-les également par le bon nom. Par exemple, je suis Inuit et je ne sais pas combien de fois on m’a appelé Innu. La communauté innue est un magnifique peuple des Premières Nations de l’est du Québec et du nord du Labrador. Donc, utilisez les bons noms. Et si vous avez un doute, parlez-en à quelqu’un et nous pourrons vous l’expliquer.
D’autre part, il faut s’adresser aux bonnes personnes. En règle générale, si la communauté a une société de développement ou un agent de développement économique, il faut commencer par cette personne.
Tout le monde pense qu’il faut s’adresser au dirigeant politique, mais il y a de fortes chances qu’elle ou il ne pourra pas vous recevoir de sitôt à cause de ses nombreuses obligations. Donc, commencez par vous adresser à la bonne personne : celle qui est chargée de développer des activités commerciales responsables au sein de sa communauté.
Troisièmement, «soyez là en personne». C’est ce qu’a affirmé Michael Sabia aujourd’hui dans le Globe and Mail, ce que j’ai trouvé très perspicace. Rendez-vous dans ces communautés et passez-y du temps : c’est à ce moment-là que la confiance s’établit réellement. Michael Sabia en a parlé aujourd’hui. Il est le PDG d’Hydro-Québec, qui est l’une des plus grandes sociétés de services publics d’Amérique du Nord. Il a parlé – Tabatha en sait probablement beaucoup à ce sujet – des nombreux voyages qu’il a effectués au sein de ces communautés, des entretiens qu’il a eus avec les dirigeantes et dirigeants, du temps qu’il a consacré à ces rencontres. Selon lui, rien ne vaut les rencontres en personne pour établir un lien de confiance. Parlez moins et soyez davantage à l’écoute.
Enfin, ce que beaucoup d’entre nous ou beaucoup d’entreprises manquent parfois de faire, c’est de commencer par la collaboration plutôt que de passer directement à la vente.
Il ne faut pas se contenter de dire : «voici le projet, nous allons tenter d’obtenir les approbations réglementaires, donc maintenant, je vais vous vendre quelque chose pour essayer de vous convaincre». À la place, faites-leur comprendre que vous les considérez comme un véritable partenaire, qui n’est pas simplement à l’arrière-plan, mais apporte également de la valeur à votre relation.
Daniel Gracian : Ici Daniel Gracian, premier directeur, Finance durable à la Banque Scotia en Amérique latine et dans les Caraïbes. Compte tenu de la forte présence de la Banque Scotia au Mexique, j’étais particulièrement enthousiaste à l’idée d’écouter Yunuen Hernandez lors du Sommet de cette année.
Yunuen est directrice du contrôle et de la surveillance des ESG pour le sous-secrétariat des finances et du crédit public du gouvernement mexicain. Elle joue un rôle essentiel dans l’élaboration du cadre de la finance durable et du programme d’émissions durables du Mexique.
En envisageant la durabilité de manière globale et en l’intégrant dans les budgets fédéraux, le Mexique s’est forgé une réputation de chef de file mondial dans le domaine de la finance durable, en particulier parmi les économies en développement.
Étant donné que l’autre table ronde s’est concentrée sur le climat, il était très intéressant d’en apprendre davantage sur la manière dont le Mexique intègre à la fois le côté social et écologique de la durabilité au sein de leurs programmes.
Yunuen Hernandez : Nos obligations sont liées aux objectifs de développement durable, car notre budget fédéral dépend des programmes fédéraux qui, eux, contribuent aux objectifs de développement durable.
C’est pour cela que notre cadre est basé sur le Programme 2030, et aussi parce que le Mexique dispose d’une gouvernance, du Comité national du Programme 2030 et de comités techniques pour assurer le suivi de politiques relatives à la durabilité avec d’autres ministères. De plus, la rétroaction positive que nous avons reçue sur notre critère géospatial a été intégrée à notre cadre.
Ce critère fait preuve d’innovation, car il permet de déterminer la manière dont les programmes sociaux sont répartis dans les régions les plus vulnérables de notre pays.
Nous ne pouvons pas uniquement nous concentrer sur l’agenda climatique. Le Mexique fait face à des défis sociaux qui doivent être réglés pour réduire les écarts. Il est logique que notre première obligation liée aux objectifs de développement durable, mise en place durant la pandémie, soit liée à tout ce qui est social, comme l’éducation et la santé. Ce n’est que deux ans plus tard que nous avons pu intégrer des obligations liées aux objectifs verts, comme la biodiversité, le changement climatique, l’énergie, etc.
Il faut donc promouvoir cette façon de faire pour une durabilité qui est à la fois verte et sociale.
Daniel Gracian : Le premier objectif de développement durable mentionné par Yunuen n’était pas seulement le premier pour le Mexique. C’était le premier de son genre au monde. Le Mexique est le chef de file dans le domaine de la finance durable et il est devenu une référence pour relever les défis actuels auxquels le marché fait face.
Lors de notre conversation avec Yunuen, elle nous a conseillé de garder une perspective à long terme pour traverser les cycles politiques.
Yunuen Hernandez : Malgré l’actualité anti-ESG, nous réalisons qu’il est normal pour un pays de s’adapter au point de vue politique actuel.
Cependant, il y a toujours une demande pour les instruments ESG, et ce, même s’il y a eu une baisse significative de l’offre dans la dernière année. La demande est toujours là, c’est pourquoi nous avons pu pénétrer les marchés internationaux et locaux avec ces instruments.
Je crois que la finance durable ne doit pas être considérée comme une stratégie à court terme, mais plutôt à long terme, afin que les cycles politiques n’affectent pas votre stratégie de finance durable. Pour y parvenir, il faut mettre en place une stratégie à long terme, comme la stratégie de mobilisation de la finance durable pour 2030.
Daniel Gracian : À la fin de la conversation, nous avons demandé à Yunuen ce que nous devions garder à l’esprit alors que nous continuons à mettre en place nos propres programmes et stratégies de finance durable dans les secteurs public et privé. Elle nous a donné ces cinq points clés à retenir.
Yunuen Hernandez : Premièrement, je crois qu’il est important que votre stratégie soit responsable. Qu’elle fasse preuve de responsabilité dans les rapports.
Deuxièmement, la transparence tout au long du processus est essentielle. Non seulement lors de la structuration d’émission d’obligations et de l’exploitation du marché, mais aussi lors des phases suivantes.
Troisièmement, permettre et promouvoir l’accès à l’information à ceux qui soutiennent les ESG pour être bien informés au moment de prendre des décisions. Tout le monde devrait avoir accès aux connaissances.
Quatrièmement, l’uniformisation est essentielle afin d’être sur la même longueur d’onde. Ce n’est pas pour se comparer aux autres ou pour devenir compétitif, c’est juste pour devenir une référence. C’est aussi pour vous permettre de voir si vous faites les choses correctement et si vous allez chercher toutes les occasions d’améliorer votre stratégie.
Finalement, le renforcement des capacités. Encore une fois, pour promouvoir ce Programme, ce n’est pas le moment de ralentir le rythme des efforts déployés. Cependant, il faut accorder beaucoup d’attention au développement des capacités dans les différents secteurs afin d’être sur la même longueur d’onde et d’aller dans la même direction.
Ben de Wit : Je m’appelle Ben de Wit, associé, Recherche sur le marché des actions à la Banque Scotia.
Cette année, la première conversation du Sommet était un entretien avec Jackie Forrest, directrice générale de l’ARC Energy Research Institute et coanimatrice du balado ARC Energy Ideas.
Lors du Sommet, plusieurs sujets ont été abordés en deux jours, mais, dans son discours, Jackie a soulevé des points importants auxquels peu s’attendaient. Notamment, la demande en combustibles fossiles semble stable, même qu’elle augmente.
Alors que certains investisseurs ont mis de côté des possibilités d’investir dans les énergies conventionnelles en raison des préoccupations entourant leurs émissions pour la durabilité à long terme, nous remarquons que les gouvernements et les marchés changent de discours pour accorder une plus grande priorité à la sécurité et la fiabilité énergétiques, d’autant plus que la demande globale en énergie ne fait qu’augmenter.
Jackie Forrest : L’histoire nous démontre que changer nos systèmes énergétiques prend beaucoup de temps parce qu’ils sont très dynamiques. Un grand nombre d’investissements a été fait dans les types d’énergies utilisés aujourd’hui. Ils ne peuvent pas être changés du jour au lendemain.
Vous savez, le charbon est un bon exemple. Tout le monde pense que le charbon est du passé. En fait, la réalité est qu’aujourd’hui notre énergie primaire provient plus du charbon que des gaz naturels. Le charbon n’a pas atteint son apogée et je ne crois pas que ça sera le cas au cours des prochaines années, parce qu’il y a encore de l’investissement dans ce secteur dans des pays comme l’Inde et la Chine.
Le charbon n’est donc pas du passé. L’énergie renouvelable ne fait que s’additionner au système des combustibles fossiles. Elle connaît une croissance rapide, mais reste moindre, car à l’heure actuelle, 80 % de notre énergie primaire provient du pétrole, du gaz et du charbon, tandis que seuls 20 % proviennent des énergies renouvelables.
Ben de Wit : Les commentaires de Jackie semblent mettre en évidence les changements que nous avons récemment observés au Canada et dans de nombreux autres pays. Nous cherchons tous à trouver un juste équilibre entre atteindre les objectifs de carboneutralité à long terme, accroître nos économies et comprendre à quoi pourrait ressembler l’alignement avec nos partenaires commerciaux à l’avenir.
Sur le plan historique, l’économie du Canada était fortement dépendante des ressources. Le projet de loi C-5, récemment adopté, semble mettre l’accent sur la manière dont nous tirons parti de nos forces traditionnelles et semble prioriser les réalisations. Je crois tout de même qu’il soit fondamental pour le Canada de trouver un juste équilibre à long terme pour tenir compte des primes d’intéressement permettant d’investir dans l’économie canadienne en plus de diversifier les occasions qui s’y trouvent.
D’ailleurs, plus tard dans son discours, Jackie a souligné quelques points particuliers en lien avec ce sujet.
Jackie Forrest : Tout d’abord, en ce qui concerne ces grands projets, le Canada doit surmonter un manque de confiance envers les gros capitaux privés pour les attirer de nouveau au pays. Comme je l’ai mentionné précédemment, plusieurs sont venus dépenser de l’argent pour constater que le Canada n’était pas vraiment ouvert à l’investissement. Nous devons changer cela.
Ce projet de loi est donc très important. Ce signal envoyé au marché indique que le gouvernement fédéral soutient le développement de grands projets d’infrastructure, et est essentiel pour reconquérir les capitaux, mais je ne pense pas qu’il soit suffisant en soi. Je crois qu’il y a un vrai désordre dans nos politiques. Vous en avez parlé tout à l’heure, certaines politiques de base doivent être corrigées.
Je vous donne un exemple. Disons, et j’espère que j’ai raison, que la construction d’installations servant à exporter le GNL fait partie des projets bâtisseurs envisagés. Donc, nous donnons le feu vert à l’exportation de gaz à partir de notre côte ouest, ce qui est une bonne chose. Nous devenons moins dépendants des Américains et ça nous donne plus d’options. Notre production peut augmenter parce que nous avons maintenant de nouveaux endroits où exporter.
En ce moment, nous sommes très limités, par conséquent, notre gaz se négocie à environ un dollar canadien par gigajoule, soit le tiers ou le quart du prix obtenu par les Américains. De cette façon, nos ressources commencent à se négocier à un prix raisonnable, mais, d’un autre côté, nous avons ce plafond pour les émissions de pétrole et de gaz qui freine l’offre. Pourquoi construire une installation d’exportation si l’offre est limitée et ne peut pas augmenter? C’est comme construire un beau grand pipeline sans jamais l’utiliser. Nous devons nous débarrasser du désordre et des contradictions qui se trouvent actuellement dans nos politiques.
Ben de Wit : Je crois qu’un élément à prendre en considération pour le long terme est la manière dont le Canada attire les investissements dans les grandes infrastructures et dans les projets bâtisseurs qui contribuent à la croissance d’autres secteurs. Tout en arrivant à un consensus sur les moyens de rendre notre économie plus résiliente pour les générations futures.
Zeeshan Nayani : Ici Zeeshan Nayani, associé, Recherche – Investissements durables et ciblés à la Banque Scotia.
Certains secteurs, dont l’énergie, les transports, l’alimentation et la construction d’infrastructures, sont notoirement difficiles à décarboner. La séance pour laquelle j’étais le plus enthousiaste était celle intitulée «Décarboner en remodelant les entreprises modernes». Elle mettait en lumière la manière dont les entreprises font avancer les choses pour relever les défis liés à la décarbonisation de ces secteurs résilients.
Cette séance regroupait des chefs de file provenant de secteurs au cœur de la conversation. Francois Bélanger, premier directeur principal, Développement durable à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; Dr Stuart Lunn, vice-président, Politique et mobilisation à la Compagnie Pétrolière Impériale ltée; Tim Faveri, vice-président de la durabilité mondiale à Nutrien; et Resha Watkins, vice-présidente du développement durable à Votorantim Cimentos, Amérique du Nord, la plus grande entreprise de ciment du Brésil et la huitième plus grande au monde.
Ces conférencières et conférenciers épatants ont présenté leurs connaissances et leurs innovations lors de cette séance. J’ai été le plus marqué par la façon dont les entreprises sont interconnectées sur le plan de la valeur et de la chaîne d’approvisionnement. De sorte qu’une innovation peut faire que plusieurs industries optent pour un avenir décarboné.
Tim Faveri : Tout le travail accompli par L’Impériale pour décarboner ses produits se répercute sur une entreprise comme Nutrien. En utilisant votre gaz naturel à faible intensité de carbone, nous réduisons l’empreinte carbone de notre production d’azote. Nous pouvons ensuite transmettre cet avantage aux parties prenantes situées en aval de la chaîne, comme les entreprises agroalimentaires et de produits de consommation courante, qui recherchent des produits à faible empreinte carbone pour réduire leurs émissions de portée 3.
Nous sommes en mesure de le démontrer scientifiquement et de le quantifier grâce à nos analyses du cycle de vie. Nous estimons que le levier le plus puissant réside dans la capacité à encourager les exploitations agricoles à adopter ce type de pratiques ou à utiliser ces produits. Ce qui compte le plus, lorsqu’on travaille avec elles, c’est de veiller à leur proposer de réelles incitations à adapter leurs pratiques.
Les agriculteurs n’ont que deux moyens de gagner leur vie : améliorer leurs rendements et obtenir un meilleur prix pour une plus grande part de leur récolte, ou bien réduire le coût de leurs intrants. Il est donc essentiel de les inciter à faire évoluer leurs pratiques. En réalité, c’est sur le marché du biodiesel, aux États-Unis, en particulier dans la ceinture de maïs, que les entreprises produisant du biodiesel proposent les incitatifs les plus importants aux exploitations agricoles de maïs et de canola, afin qu’elles fournissent des matières premières pour un carburant à plus faible intensité de carbone. Cette dynamique crée de nouvelles possibilités pour les agriculteurs.
Cette perspective les intéresse beaucoup. Comme nous travaillons directement sur le terrain avec les exploitations agricoles par l’intermédiaire de nos agronomes et de nos fournisseurs d’intrants agricoles, nous sommes en mesure d’évaluer l’adoption de pratiques et l’utilisation d’engrais à faible intensité carbone. Ces pratiques permettent de produire un canola ou un maïs à faible empreinte carbone, acheminé ensuite vers votre usine. Et bien sûr, nous espérons qu’un tel effort permettra d’obtenir un meilleur prix. Par ailleurs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre constitue un avantage considérable en soi.
François Bélanger : Tim, vous disiez tout à l’heure que l’alimentation est au centre de tout. Si vous me le permettez, je dirais que le rail joue, lui aussi, un rôle central.
En effet, en ce qui concerne les biocarburants, nous acheminons d’abord une partie de la potasse destinée aux exploitations agricoles, puis nous transportons les matières premières vers les raffineries, avant d’expédier le produit fini à sa sortie. Ce rôle nous offre une vision d’ensemble de la chaîne des carburants renouvelables, et nous y voyons de réelles perspectives de croissance commerciale. C’est ce qui rend l’ouverture de notre site de Strathcona à la fois stimulante et prometteuse.
Du côté des consommateurs, comme je le mentionnais précédemment, il s’agit de notre principal levier d’action pour atteindre nos objectifs à l’horizon 2030. Nous y voyons une possibilité de réduire nos émissions dès à présent, sans modification majeure de nos locomotives, tant que nous restons sous un certain seuil de mélange. Nos carburants contiennent donc déjà une part croissante de biocarburants.
En 2024, nous avons atteint environ 10 % de carburant renouvelable pour nos locomotives, grâce à un mélange de biodiesel et de diesel renouvelable. Cela permet une réduction immédiate de nos émissions. Ce faisant, nous contribuons également à réduire directement les émissions de portée 3 liées au transport des marchandises pour notre clientèle.
Patrycja Drainville : Ici Patrycja Drainville, première directrice, Finance durable à la Banque Scotia.
À la lumière de l’attention médiatique et politique portée aux placements ESG, il est plus important que jamais d’écouter ce que la communauté des investisseurs a à dire. En fin de compte, les solutions axées sur le marché ne fonctionnent que s’il existe une demande durable. Après tout, ce sont les investisseurs qui ont placé les enjeux ESG sous les feux des projecteurs en leur donnant une place centrale dans les stratégies de placements.
C’est pourquoi j’étais très enthousiaste à l’idée d’écouter les réflexions des participantes et participants au panel sur l’évolution des placements durables du point de vue des investisseurs. Cambyse Parsi et Francisco Suarez, deux BanquiersScotia, ont animé une discussion dynamique à laquelle ont participé Patrick O’Connell, directeur des solutions de portefeuille et de la recherche en matière de placements responsables à AllianceBernstein; Heather Sharpe, analyste principale en recherche ESG à Jarislowsky, Fraser Limited; Marina Severinovsky, directrice du développement durable en Amérique du Nord à Schroeders; Daniel Yungblut, vice-président et chef de la recherche à Scotia Gestion mondiale d’actifs; et Barbara Zvan, présidente et cheffe de la direction d’University Pension Plan Ontario (UPP).
Les investisseuses et investisseurs participant au panel ont convenu de la nécessité d’adopter une approche pragmatique en ce qui concerne les placements ESG. Le groupe a également souligné qu’il est essentiel de tenir compte des risques et des possibilités liés au développement durable pour générer des rendements ajustés au risque sur le long terme.
Lorsqu’il s’agit d’intégrer la durabilité dans les décisions de placement, Barbara et Patrick ont insisté sur l’importance de la clarté, de la matérialité financière et de la prise de décision fondée sur des données probantes, plutôt que sur des exclusions ou des quotas appliqués de façon simpliste.
Barbara Zvan : Notre approche est donc ancrée dans la matérialité financière parce que, comme vous le savez, la loi exige que les régimes de retraite soient gérés dans l’intérêt de leurs participantes et participants; intérêt qui est généralement, et parfois même explicitement, de nature financière. C’est pourquoi nous avons toujours abordé cette question sous l’angle de la matérialité financière. Il s’agit donc davantage d’un processus que d’un produit. En réalité, notre réflexion s’inscrit dans une perspective à très long terme.
En général, les membres de notre personnel commencent à travailler chez nous entre le début et la fin de la vingtaine, tandis que les membres du corps professoral, pour leur part, intègrent notre organisation à un âge un peu plus avancé. Nous continuerons donc à leur verser des prestations de retraite lorsqu’elles et ils atteindront 90 ans. Il s’agit donc de risques qui s’inscrivent dans un horizon à très long terme.
Patrick O’Connell : Je pense que la clarté est un élément sur lequel nous avons dû vraiment progresser au cours des deux dernières années. Si, par le passé, on pouvait se contenter de termes flous (comme «durable», «enjeux ESG», «intégration», «impact»…), il me semble qu’aujourd’hui, nous devons adopter un langage beaucoup plus clair et normatif quant à la nature de nos activités.
Nous sommes un important gestionnaire d’actifs, avec environ 800 milliards de dollars sous gestion. Nos activités couvrent plus ou moins les mêmes catégories que celles du marché, mais elles reposent en grande partie sur l’intégration des enjeux ESG. Par ailleurs, bon nombre des membres de notre clientèle s’intéressent aux placements durables ou responsables. Mais selon moi, c’est bien de l’intégration dont nous devons réellement parler aujourd’hui.
Il s’agit d’abord de définir clairement ce qui relève, ou non, de l’intégration des enjeux ESG. C’est avant tout une question de matérialité financière : comment ces facteurs peuvent-ils contribuer à améliorer les résultats à long terme? J’ajouterais ensuite l’importance du «pourquoi», soit la matérialité financière révélée par les évaluations rétroactives, en montrant qu’il ne s’agit pas d’enjeux relevant de logiques altruistes.
Cette approche permet d’atteindre des rendements supérieurs, que l’on soit actionnaire ou obligataire. Il faut être ferme sur ce point, car c’est un message qui, selon moi, résonne bien auprès des investisseurs.
Patrycja Drainville : En fin de compte, la conclusion la plus importante est que les enjeux ESG doivent contribuer à améliorer les résultats financiers pour les investisseurs. Le gestionnaire d’actifs institutionnel Jarislowsky, Fraser avait intégré les enjeux ESG dans son processus d’analyse ascendante bien avant que ce concept soit nommé ainsi. Interrogée sur les preuves empiriques externes venant appuyer leur approche en matière de placements ESG, Heather Sharpe a mentionné une récente métaétude menée par l’Université de New York.
Heather Sharpe: Je citerai simplement une vaste métaétude menée par l’Université de New York, qui s’appuie sur des milliers de recherches, y compris d’autres métaétudes portant sur la période de rendement allant de 2015 à 2020. Bien sûr, le contexte mondial a beaucoup évolué depuis 2020, mais cette métaétude a tout de même mis en évidence une corrélation positive entre les enjeux ESG et le rendement financier des entreprises.
Ainsi, certains indicateurs, tels que le rendement des capitaux propres, le rendement des actifs ou encore le cours réel des actions, ont connu une progression à long terme, tandis que ces entreprises se sont également montrées moins volatiles sur les marchés baissiers. Mais si l’on adopte une approche ascendante fondée sur les fondamentaux, nous estimons que l’intégration des facteurs ESG ayant une incidence financière contribuera à faire émerger de meilleures entreprises sur le long terme. À partir de ces entreprises de qualité, il est alors possible de construire des portefeuilles mieux positionnés pour générer des rendements ajustés au risque plus durables à long terme.
Patrycja Drainville : Cela montre bien que l’alpha ne provient pas des exclusions, mais de l’intégration des principes ESG à partir de l’analyse des fondamentaux.
Je pense qu’il s’agit là d’un enseignement important pour l’ensemble des investisseurs. Marina Severinovsky, de Schroders, une société qui mène une quantité considérable de travaux de recherches exclusifs sur le développement durable, nous a rappelé que rendement financier et impact peuvent aussi provenir d’entreprises en transition.
Marina Severinovsky : En matière de climat, par exemple, nous distinguons trois catégories d’entreprises : celles en transition qui améliorent leur empreinte carbone, celles à faible intensité carbone, et celles qui proposent des solutions climatiques.
En réalité, ce que nous observons, c’est que la catégorie des entreprises qui améliorent leur empreinte carbone (en entreprenant une transition ou en prenant des mesures concrètes) est à la fois la plus importante et la plus diversifiée, tous secteurs confondus. C’est aussi celle qui a enregistré le plus fort rendement financier. Mais surtout, elle est celle qui a contribué à la plus grande réduction des émissions dans le monde réel, comparativement aux autres catégories, puisque les entreprises proposant des solutions climatiques ou à faible intensité carbone sont, par définition, déjà très peu émettrices.
Par conséquent, pour viser un meilleur rendement ou des progrès plus tangibles, ces entreprises constituent une cible privilégiée.
En ce qui concerne l’engagement et la création de valeur, nous avons publié une analyse montrant que les entreprises avec lesquelles nous menons un dialogue actif sont davantage susceptibles de réduire l’intensité de leurs émissions et d’afficher de meilleurs rendements.
Il ne s’agit pas d’un lien de causalité établi, mais la corrélation est incontestablement très forte. Nous avons également observé une corrélation très forte entre l’engagement actionnarial, y compris le vote par procuration sur les questions de gouvernance, et l’amélioration durable du rendement des entreprises.
Encore une fois, parmi les leviers dont nous disposons en tant qu’investisseuses et investisseurs, je considère que l’engagement actionnarial est véritablement essentiel.
Patrick Bryden : Des perspectives remarquables à tous les niveaux. Mettre en place ce projet a été un véritable défi, mais les deux journées que nous avons passées ensemble à Toronto ont été riches en moments forts.
Je tiens à remercier mes collègues Melissa Menzies, Cambyse Parsi, Daniel Gracian, Benjamin de Wit, Zeeshan Nayani et Patrycja Drainville pour leur contribution à cet épisode, ainsi que l’ensemble des panélistes et des personnes ayant participé au 7e Sommet annuel de la Banque Scotia sur la durabilité.
Nous nous réjouissons à l’idée de vous retrouver lors du Sommet de 2026. Si vous souhaitez contribuer à façonner l’avenir du développement durable et prendre part à la conversation, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus.
Merci de votre attention!
Présentatrice : Merci d’avoir écouté le balado Le point sur les marchés de la Banque Scotia. N’oubliez pas de suivre l’émission sur votre plateforme de balado préférée. Vous pouvez aussi consulter notre site Web https://www.gbm.scotiabank.com/fr.html pour d’autres émissions riches en réflexions.
Market Points is designed to provide you with timely insights from Scotiabank Global Banking and Markets' leaders and experts.
Get new episodes right on your device by following us on your preferred podcast network: